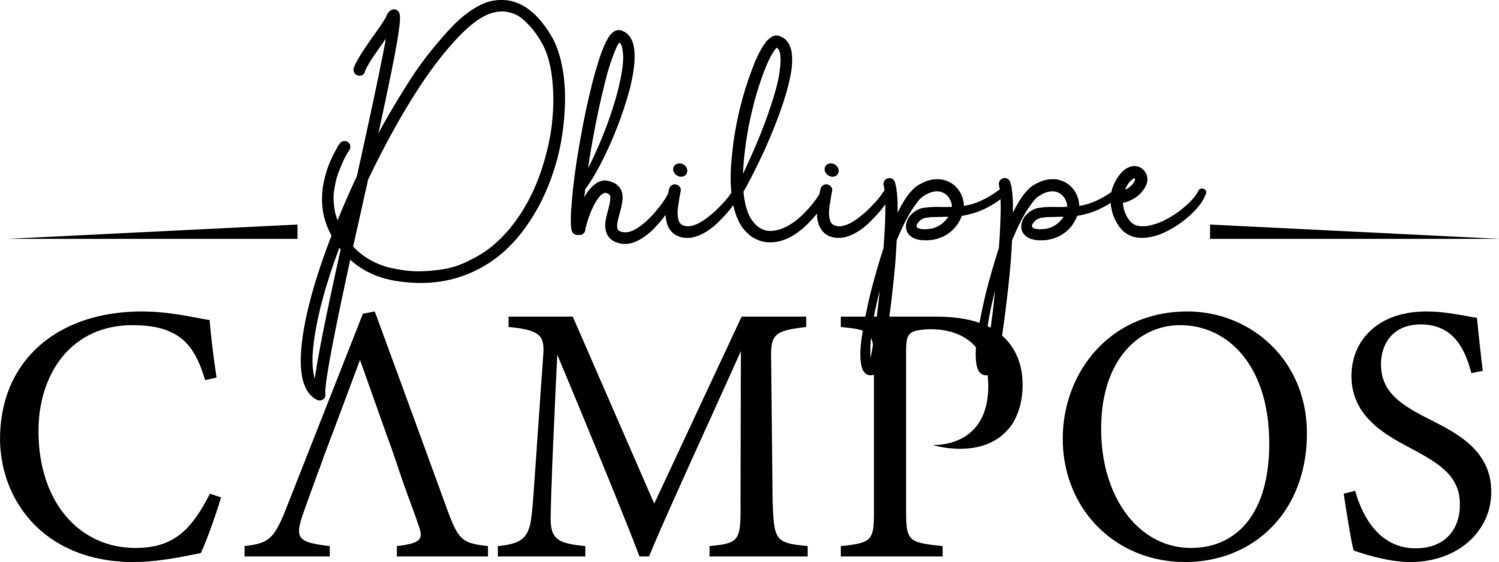Lorsqu’une partie à un litige réclame réparation de son préjudice, la demande repose généralement sur le manque à gagner ou les pertes subies. Cependant, certains aspects de l’évaluation du préjudice peuvent être négligés. Parmi eux, les intérêts compensatoires, qui traduisent la dimension financière du dommage. Pourtant, cette composante n’est pas systématiquement prise en compte, soit par oubli, soit en raison d’une justification insuffisante ou d’une méconnaissance de ses fondements.
Le fondement des intérêts compensatoires
L’estimation des intérêts compensatoires repose sur un principe fondamental de l’évaluation des préjudices économiques : la réparation doit replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée en l’absence des faits dommageables.
Ces intérêts visent ainsi à compenser la privation de l’usage de la trésorerie durant la période où le préjudice a été subi. Ils traduisent la valeur temporelle des fonds dont la victime a été privée. Cette privation peut résulter de plusieurs situations, notamment :
- Un coût financier direct : l’entreprise a dû souscrire un emprunt ou recourir à un découvert pour financer un investissement ou des dépenses, entraînant des charges financières supplémentaires.
- Un coût financier indirect : si l’entreprise avait perçu les fonds, elle aurait pu réduire ses emprunts ou ses découverts, limitant ainsi ses charges financières.
- Un coût financier d’opportunité : en l’absence des faits dommageables, l’entreprise aurait pu investir les sommes disponibles dans des placements ou des projets rentables.
En d’autres termes, les intérêts compensatoires incarnent la dimension financière du préjudice économique, en traduisant la perte liée à l’immobilisation forcée des capitaux et à l’absence de leur mise à profit.
Dans ces circonstances, il arrive que les défendeurs contestent le principe même des intérêts compensatoires, soit par méconnaissance réelle, soit par stratégie opportuniste. Dans ce cas, les hypothèses retenues pour leur calcul sont souvent rejetées d’un simple revers de la main. Pourtant, cette posture s’avère généralement maladroite : en l’absence de contre-argumentation solide, les véritables hypothèses susceptibles d’impacter l’évaluation du demandeur restent peu discutées, laissant ainsi place à une estimation potentiellement unilatérale en raison du comportement du défendeur.
La dimension temporelle des intérêts compensatoires
Les intérêts compensatoires prennent naissance à partir du fait générateur du dommage, c’est-à-dire dès l’instant où un coût financier peut être constaté en raison du comportement fautif du défendeur. Toutefois, leur point de départ effectif peut être postérieur, selon les circonstances propres à chaque affaire. En pratique, la période de calcul des intérêts compensatoires découle directement du préjudice principal, qu’il s’agisse d’un gain manqué ou d’une perte subie.
Le calcul de ces intérêts repose sur le principe de progressivité du préjudice, qui reflète l’évolution graduelle du dommage au fil du temps, plutôt qu’une atteinte instantanée et définitive. Cette notion est essentielle pour assurer une indemnisation juste, car elle permet d’ajuster l’évaluation des intérêts en fonction de l’aggravation progressive du préjudice. Ainsi, lorsqu’une perte financière ou un dommage s’accroît au fil du temps, il est plus approprié de tenir compte de cette évolution plutôt que d’appliquer un taux uniforme dès une date unique.
Par conséquent, les intérêts compensatoires peuvent être calculés selon une approche proportionnelle à la montée en charge du préjudice, garantissant ainsi une réparation plus fidèle à la réalité du dommage subi par la victime. Ce principe est particulièrement pertinent lorsque le préjudice s’étend sur une longue période avec des montants et des taux variables selon les années.
En général, le calcul des intérêts compensatoires peut s’étendre jusqu’à la date du jugement statuant sur leur octroi. Toutefois, certains demandeurs retiennent parfois des dates antérieures, telles que celle de l’introduction de l’instance, ce qui peut donner lieu à des débats sur la période réellement applicable.
Par ailleurs, certaines circonstances peuvent justifier une période de fin plus courte que celle de la date du jugement. Par exemple, dans le cas d’un préjudice économique fondé sur des gains manqués pluriannuels, comment l’entreprise pourrait-elle justifier d’un préjudice financier en trésorerie si elle distribue l’intégralité de ses bénéfices à ses associés ? En d’autres termes, si l’entreprise ne conserve pas la trésorerie disponible, elle ne peut prétendre à une compensation financière sur une longue période, puisque l’indisponibilité des fonds ne se prolonge pas dans le temps.
Toutefois, la réponse n’est pas uniforme et dépend des circonstances exactes propres à chaque entreprise. L’évaluation de la durée du préjudice doit donc tenir compte des choix financiers de l’entreprise et de leur impact sur la réalité de la privation de trésorerie.
Ne pas confondre les intérêts compensatoires et les intérêts moratoires
Les intérêts compensatoires sont parfois confondus avec les intérêts moratoires, bien qu’ils reposent sur des logiques distinctes.
- Les intérêts compensatoires ont pour but d’indemniser la victime pour la privation de l’usage de sa trésorerie durant la période précédant la reconnaissance du préjudice. Ils couvrent donc le préjudice financier jusqu’à la date du jugement (en principe).
- Les intérêts moratoires, quant à eux, visent à réparer le préjudice résultant d’un retard de paiement d’une somme d’argent déjà reconnue comme due. Ils courent généralement à compter de la date du jugement qui accorde l’indemnisation.
En pratique, les intérêts moratoires sont appliqués aux dommages et intérêts accordés par la juridiction et sont calculés sur la base des taux d’intérêt légaux fixés par le législateur (voir par exemple les articles 1231-6 et 1231-7 du code civil).
Ainsi, pour simplifier :
👉 Les intérêts compensatoires couvrent la période précédant le jugement (intérêts qui compensent la privation de trésorerie).
👉 Les intérêts moratoires couvrent la période postérieure au jugement (retard de paiement de l’indemnisation).
Les taux d’intérêt à utiliser pour le calcul des intérêts compensatoires
Contrairement aux intérêts moratoires, les intérêts compensatoires ne sont pas calculés sur la base des taux d’intérêt légaux. Leur détermination repose sur une analyse des circonstances spécifiques du préjudice subi, afin d’identifier un taux d’intérêt représentatif de la perte financière.
Voici quelques exemples de fondements possibles pour le choix du taux d’intérêt applicable :
- Cas d’une entreprise ayant dû emprunter ou utiliser un découvert :
Lorsqu’une entreprise a contracté un emprunt, subi un découvert ou n’a pas pu réduire son endettement en raison du fait dommageable, le calcul des intérêts compensatoires peut se fonder sur les taux de financement effectifs de l’entreprise. Ces taux peuvent être justifiés par des rapports annuels mentionnant les taux d’emprunt (si certifiés par un commissaire aux comptes) ou encore par les contrats bancaires attestant des conditions de financement appliquées. - Cas d’une entreprise ayant subi une perte liée à l’impossibilité d’un placement financier :
Si l’entreprise estime que son préjudice provient de l’impossibilité d’effectuer un placement financier, elle devra apporter une justification précise des taux d’intérêt dont elle aurait pu bénéficier sur la période concernée. Cette justification devra être étayée par une documentation probante, telle que des relevés d’investissements passés ou des données financières attestant des rendements potentiels sur des supports similaires.
L’expert chargé de l’évaluation prendra en compte les risques associés au placement financier. Ainsi, si l’entreprise revendique une rémunération supérieure à celle d’un placement sans risque, il conviendra d’intégrer dans l’analyse le niveau d’incertitude et de risque inhérent à l’investissement. Autrement dit, plus le rendement espéré est élevé, plus il sera nécessaire de démontrer que ce gain potentiel était réellement atteignable et non purement spéculatif.
En résumé, le taux d’intérêt utilisé pour le calcul des intérêts compensatoires doit être cohérent avec la nature du préjudice subi et objectivement justifiable par des éléments comptables ou contractuels.
Si les pièces justificatives ne sont pas fournies à l’expert pour procéder à l’estimation ou pour en vérifier la pertinence, celui-ci pourra soit écarter le chiffrage, soit retenir une hypothèse alternative. Dans ce cas, il pourra se baser sur les taux d’emprunt d’État (ou taux sans risque) comme référence pour l’évaluation.
Toutefois, en l’absence de données précises fournies par l’entreprise, l’expert devra émettre les réserves d’usage quant à la fiabilité de son estimation, celle-ci n’étant pas directement liée aux caractéristiques spécifiques de l’entreprise concernée. Ces réserves permettront au juge de statuer en toute connaissance de cause, en tenant compte des incertitudes inhérentes à l’évaluation.
D’ailleurs, à ce sujet, il est intéressant de noter que la fiche n°7 publiée par la Cour d’appel de Paris sur le thème « Comment réparer les préjudices liés à l’écoulement du temps ? » (version de janvier 2024) [1] mentionne, à propos des intérêts compensatoires :
👉 « En l’absence de preuve d’un préjudice spécifique, il y a lieu d’appliquer à la somme dont la victime a été privée le taux d’intérêt légal correspondant à un placement sans risque (Com. 7 juin 2023, n°22-10545). »
Certaines entreprises justifient le taux d’intérêt compensatoire en se basant sur un coût d’opportunité associé au coût du capital, qui correspond à la moyenne pondérée du coût des fonds propres et de la dette. Ce taux, couramment utilisé pour l’évaluation des entreprises par la méthode des flux de trésorerie futurs (DCF), est généralement élevé et peut conduire à une augmentation significative des intérêts compensatoires en comparaison de ceux qui seraient déterminés à partir du coût d’un financement bancaire par exemple.
Cependant, cette approche présente plusieurs limites majeures :
- Une référence à des coûts du capital inadaptés : certaines entreprises fondent leur raisonnement sur des coûts du capital d’entreprises cotées, dont les caractéristiques financières peuvent être très différentes de celles de l’entreprise concernée. En conséquence, les taux retenus sont parfois nettement supérieurs aux taux réels de financement ou de placement de l’entreprise.
- Une hypothèse de préjudice trop incertaine : choisir le coût du capital comme taux de référence suppose que le préjudice subi a empêché l’entreprise de réaliser un autre projet rentable. Or, un tel raisonnement implique deux conditions difficiles à prouver :
- L’identification claire d’un projet d’investissement non réalisé, directement empêché par le préjudice principal.
- L’hypothèse que ce projet aurait été une réussite, alors même qu’il s’agit d’un placement risqué. Cette incertitude relève alors d’une perte de chance, impliquant une prise en compte d’un taux de probabilité d’occurrence d’une éventualité favorable.
Ainsi, l’utilisation du coût du capital pour justifier le taux des intérêts compensatoires reste une exception et comporte un risque élevé de non-reconnaissance par l’expert le cas échéant et, surtout, le juge. Les demandeurs qui privilégient cette approche doivent être en mesure de documenter rigoureusement leur préjudice pour éviter un rejet de leur demande.
La capitalisation des intérêts
Lorsqu’elle est admise, la capitalisation des intérêts consiste à rémunérer non seulement le capital initial, mais aussi les intérêts précédemment calculés et échus. En d’autres termes, les intérêts échus sont capitalisés pour produire eux-mêmes intérêt. Cette question est cruciale, car son impact peut être significatif en fonction de la durée du préjudice et du niveau des taux appliqués. Dès lors, les parties peuvent débattre de l’opportunité de capitaliser ou non les intérêts compensatoires.
Certains soutiennent que la capitalisation ne se présume pas, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil :
« Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. »
D’autres [2], en revanche, considèrent que cet article du Code civil ne s’applique pas au calcul des intérêts compensatoires, dès lors que ceux-ci constituent une composante du préjudice principal et relèvent donc du principe de réparation intégrale.
À mon avis, la réponse n’est pas binaire. Le fondement des intérêts compensatoires doit prendre en compte les circonstances propres du demandeur :
- Si les intérêts compensatoires résultent du rendement d’un placement, il paraît logique que les intérêts échus auraient eux-mêmes pu être placés et générer des intérêts. Toutefois, certaines circonstances particulières pourraient justifier l’exclusion de cette hypothèse, notamment si l’entreprise destinait ces revenus à un autre usage.
- Si les intérêts compensatoires résultent d’un coût de financement, la capitalisation des intérêts n’est généralement pas admise dans le cadre des financements bancaires classiques notamment puisque les intérêts ne sont pas capitalisés ; certains cas peuvent justifier une capitalisation des intérêts :
- Les prêts assortis de franchises de remboursement sur une certaine période, où les intérêts peuvent être capitalisés.
- Certains financements spécifiques, comme les LBO avec un prêt mezzanine, où la capitalisation des intérêts peut être prévue contractuellement.
- Le financement par compte courant d’associé, dans lequel les intérêts peuvent être capitalisés selon les accords en vigueur.
Ainsi, cette approche permet de replacer la victime dans la situation qui aurait été la sienne en l’absence des faits dommageables, de manière plus pertinente et adaptée à la réalité économique du préjudice subi pour la personne concernée.
Les intérêts compensatoires : un enjeu souvent sous-estimé
Il arrive que les intérêts compensatoires soient peu justifiés, insuffisamment documentés, voire totalement omis par le demandeur.
Dans ces circonstances, l’estimation du préjudice économique peut ne pas intégrer ces intérêts, soit par manque de justification, soit parce qu’ils n’ont pas été explicitement demandés.
Quel rôle pour l’expert de justice dans ce contexte ?
L’intervention de l’expert dépendra du périmètre de sa mission.
Par exemple, de nombreuses expertises sont ordonnées sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, qui vise une mesure d’instruction en vue d’un éventuel procès au fond. Dans ce cadre, les missions sont souvent limitées à certains points spécifiques, sans forcément conduire à un chiffrage détaillé du préjudice économique. Dans ce cas, l’expert aura peu d’initiative pour aborder la question des intérêts compensatoires.
En revanche, si l’expertise porte directement sur l’évaluation d’un préjudice économique, l’expert pourra discuter et examiner les hypothèses retenues pour le calcul des intérêts compensatoires. Toutefois, une difficulté peut apparaître si ces intérêts sont sous-évalués au regard du contexte et de la situation du demandeur. En effet, l’article 4 du Code de procédure civile prévoit que le juge ne peut statuer au-delà des demandes des parties (principe ne ultra petita). En revanche, l’expert n’est pas soumis à cette limite. Il peut donc proposer une estimation plus large que celle initialement formulée, permettant ainsi au demandeur d’ajuster sa demande si nécessaire.
À l’inverse, dans certains cas, l’expert peut être amené à limiter ou écarter les intérêts compensatoires si les spécificités du litige ne justifient pas leur application ou si leur évaluation repose sur des hypothèses trop incertaines.
Conclusion : L’enjeu des intérêts compensatoires dans l’indemnisation du préjudice économique
Les intérêts compensatoires constituent un élément clé dans l’évaluation des préjudices économiques, mais ils sont souvent mal documentés ou tout simplement oubliés par les demandeurs. Pourtant, ils traduisent une réalité économique indéniable : la privation d’une trésorerie qui aurait pu être utilisée à des fins de financement ou d’investissement.
Leur justification repose sur plusieurs paramètres : la nature du préjudice, la durée de la privation de fonds et le taux d’intérêt applicable. Cependant, leur calcul et leur prise en compte suscitent des débats, notamment sur leur capitalisation, la période à retenir et la méthode d’évaluation la plus adaptée.
Enfin, la reconnaissance des intérêts compensatoires demeure un enjeu stratégique dans l’indemnisation du préjudice. Une demande mal justifiée risque d’être évaluée à la baisse ou écartée par l’expert et le juge. À l’inverse, une analyse rigoureuse et documentée permet une indemnisation juste et cohérente avec les principes de réparation intégrale.
Ainsi, les intérêts compensatoires ne devraient plus être négligés dans l’estimation du préjudice économique, mais considérés comme une composante essentielle à prendre en compte dans toute démarche indemnitaire.
Philippe CAMPOS
Associé AFIVAL
Expert-comptable diplômé
Expert près la Cour d’appel de Paris
Expert près les Cours administratives d’appel de Paris et de Versailles
Expert devant la Cour pénale internationale
Notes :
[1] Source : https://www.cours-appel.justice.fr/paris/la-reparation-du-prejudice-economique
[2] Cf. chapitre 5, section § 1.2.3 de la brochure « Points clés relatifs à l’évaluation des préjudices économiques » publié par la Compagnie nationale des experts-comptables de justice en Mars 2018.
VERSION VOCALE DE L’ARTICLE :