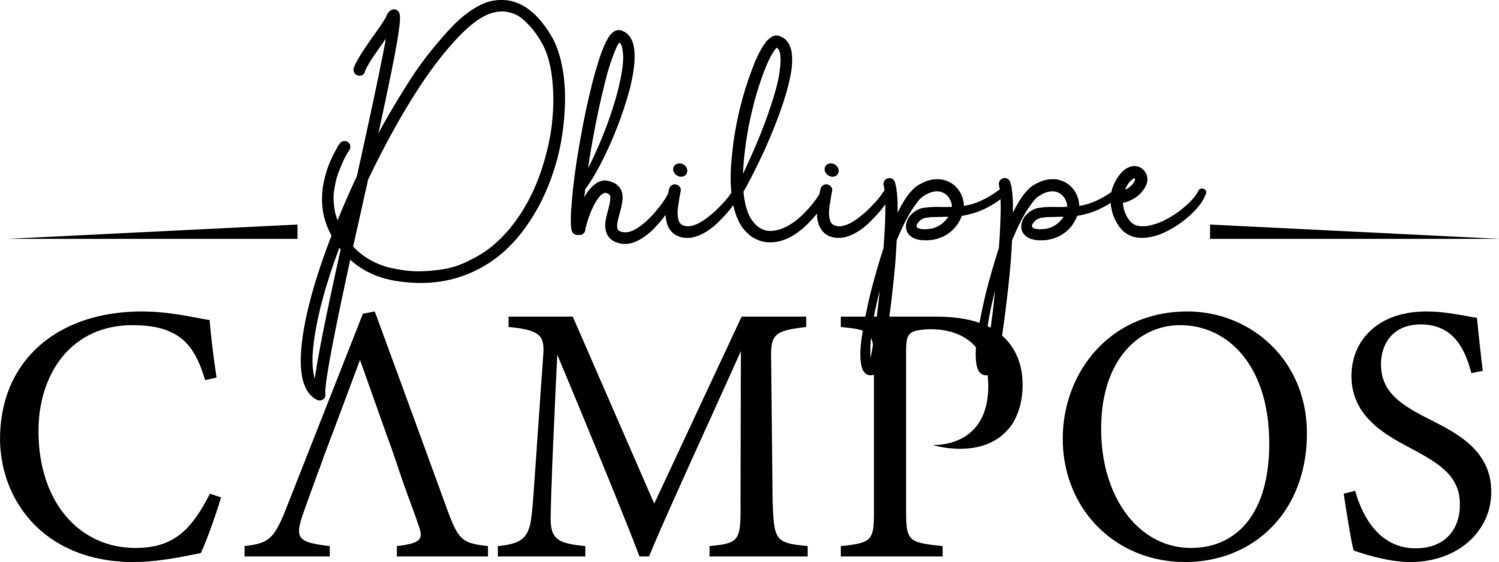Dans un contentieux fiscal opposant un groupe français à l’administration, la Cour administrative d’appel de Paris rappelle, dans une décision du 5 mars 2025, l’importance de fonder rigoureusement les paramètres du taux d’actualisation dans une évaluation par la méthode des flux de trésorerie actualisés (Discounted Cash Flows – DCF) ou ses équivalents.
En l’espèce, l’administration contestait le prix de cession retenu pour une opération intragroupe, estimant qu’il s’éloignait de manière significative de la valeur vénale de l’entité cédée. Une telle sous-valorisation, selon elle, révélait un acte anormal, justifiant une rectification fiscale.
La décision rendue précise les éléments suivants :
- Le prix de cession avait été déterminé sur la base d’une approche DCF construite à partir d’un plan d’affaires prévisionnel sur cinq ans, puis avec un taux de croissance à l’infini fixé à 0,5 %.
- Le taux d’actualisation retenu s’appuyait sur un taux sans risque de 3,1 % (correspondant à la moyenne sur deux ans des OAT 10 ans françaises), une prime de risque de marché de 8,56 %, ainsi que des coefficients beta différenciés : 0,62 pour les segments « Logistics and Commercial » et « Working Capital », et 1,1 pour l’activité « Wholesale ».
- Il en résultait une valeur d’entreprise estimée à 920 millions d’euros.
Bien que plusieurs paramètres aient été discutés, c’est sur la seule question de la prime de risque de marché que se concentre l’analyse ici.
L’administration, contestant le caractère réaliste du taux d’actualisation appliqué, soutenait qu’il était excessivement élevé au regard :
- de la position dominante de l’entité sur son marché,
- de la comparaison avec d’autres transactions ou évaluations sectorielles,
- et des perspectives de rendement du marché actions français.
Elle préconisait une prime de risque de marché déterminée sur une base historique à long terme, s’appuyant sur plusieurs références :
- 6,62 % selon l’étude Ibbotson de 2012,
- 6,6 % selon l’étude de l’AMF (décembre 2013) fondée sur le rendement réel net d’inflation d’un portefeuille d’actions françaises entre 1988 et 2013,
- ou encore 7,3 % sur la base du rendement annualisé moyen sur vingt ans issu de la base Bloomberg.
Selon cette approche et l’administration, la valeur d’entreprise aurait dû être portée à 1 169 millions d’euros, soit un écart de valorisation de près de 27 % avec celle retenue initialement.
Sur le choix même d’une approche historique, la Cour administrative d’appel constate que :
- L’approche historique est marginale dans la mise en œuvre de la méthode DCF. Une étude de 2017 citée par la société établit que plus de 85 % des cas étudiés utilisent une méthode prospective.
- L’administration n’apporte aucun fondement théorique ni exemple concret d’évaluation par des tiers qui viendraient justifier le recours à une méthode historique en lien avec l’horizon d’investissement ou la position dominante de l’acquéreur sur son marché.
- Elle n’explique pas pourquoi le coût du capital devrait refléter une vision subjective à long terme plutôt que la réalité objective du marché à la date de l’opération, ajustée par les coefficients bêta spécifiques à chaque activité.
- En période de volatilité accrue (comme en 2012), l’utilisation d’une moyenne historique peut générer une décorrélation importante entre la prime de risque estimée et les exigences réelles des investisseurs.
- Le fait que KPMG ait utilisé une méthode historique en 2008 pour une évaluation antérieure ne saurait suffire à en imposer la reprise en 2012. Les conditions de marché avaient significativement changé depuis lors.
Sur la mise en œuvre concrète de la méthode historique, même en admettant le recours à une approche historique, la Cour relève plusieurs incohérences méthodologiques :
- L’administration combine un taux sans risque à court terme (2 ans) avec une prime de risque construite sur le long terme, ce qui biaise la logique de cohérence temporelle.
- En appliquant un taux sans risque de long terme (5,8 %), la société montre que la méthode historique aboutirait à un coût du capital quasi équivalent au sien (11,8 % contre 11,66 %), ce que l’administration ne réfute pas sérieusement.
- L’administration reproche à tort un taux de coût du capital jugé trop élevé en raison d’un prétendu monopole de marché, alors que ce risque est déjà intégré dans le coefficient bêta de 0,62 utilisé par la société… et repris tel quel par l’administration elle-même.
- Enfin, le choix de retenir un taux médian de 6 % parmi des références allant de 2 % à 11,4 %, sans justification claire, est critiqué : l’étude évoquée mentionnait d’ailleurs un taux de 8,56 % parfaitement compatible avec celui retenu par la société.
La Cour souligne ainsi que l’administration ne justifie ni le choix du taux retenu, ni l’exclusion d’autres points de comparaison pourtant cohérents avec les standards du marché.
La Cour administrative d’appel de Paris rend finalement une décision favorable au contribuable, en annulant le jugement de première instance. Elle estime que l’administration n’a ni justifié le recours à une méthode d’évaluation marginale en pratique (l’approche historique de la prime de risque), ni appliqué cette méthode de manière cohérente sur le plan technique.
Une décision qui agit comme une piqûre de rappel pour certains praticiens de l’évaluation
La décision rendue par la Cour administrative d’appel de Paris ne se limite pas à trancher un litige fiscal : elle offre une leçon méthodologique bienvenue à destination de certains praticiens de l’évaluation financière. Elle remet en lumière plusieurs principes fondamentaux, parfois relégués au second plan dans les débats techniques ou les négociations contentieuses :
- L’importance des paramètres actuariels ne saurait être relativisée
Il arrive que certains praticiens considèrent les paramètres actuariels (taux sans risque, prime de risque, coefficients bêta…) comme accessoires par rapport aux fondamentaux du business plan. Ce raisonnement est trompeur. L’étude sérieuse de ces éléments ne s’oppose nullement à l’analyse des données opérationnelles ; elle en est le prolongement nécessaire pour donner corps à une évaluation DCF crédible. C’est justement l’articulation rigoureuse entre le narratif économique et les hypothèses financières qui garantit la robustesse de l’exercice d’évaluation.
- La prime de risque prospective : un standard professionnel
Sans le dire explicitement, la Cour confirme que l’approche prospective constitue aujourd’hui la norme de marché. Dès lors que la prime de risque utilisée s’appuie sur une source fiable, sa contestation suppose des arguments étayés. Opposer une moyenne historique ne suffit pas.
- La cohérence globale du modèle prime sur le choix isolé d’un paramètre
L’une des dérives fréquentes dans les contentieux d’évaluation consiste à extraire un seul paramètre du modèle – celui qui sert la démonstration – sans reconstituer l’équilibre d’ensemble. En l’espèce, l’administration a retenu une prime de risque historique, mais sans ajuster en conséquence le taux sans risque, qu’elle a laissé à court terme.
La société requérante a justement mis en lumière cette incohérence : si l’on choisit une perspective historique pour la prime, il faut en toute logique retenir un taux sans risque avec une maturité comparable, afin d’obtenir une rentabilité de marché homogène. C’est cette approche que je défends également sur ce point particulier dans mon ouvrage Évaluation d’une entreprise non cotée – Le point de vue d’un praticien (question n° 61, édition 2018).
Source : CAA de Paris du 5 mars 2025, 23PA03081.
Philippe Campos.
- A lire également sur le sujet (article de 2013) : https://philippecampos.com/prime-de-risque-de-marche/
- Formations consacrées à l’évaluation d’entreprise et à ces problématiques :
https://formations.philippecampos.com/fr/inscription-premium/